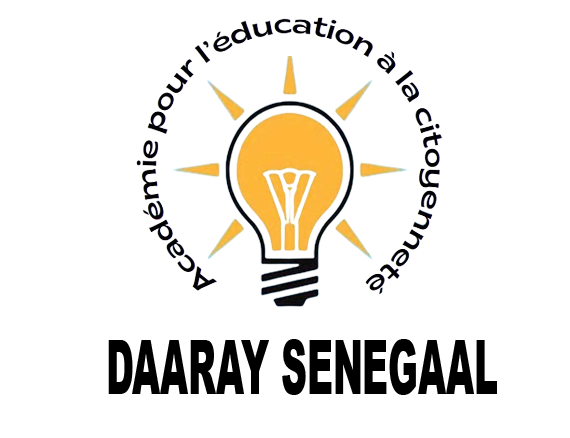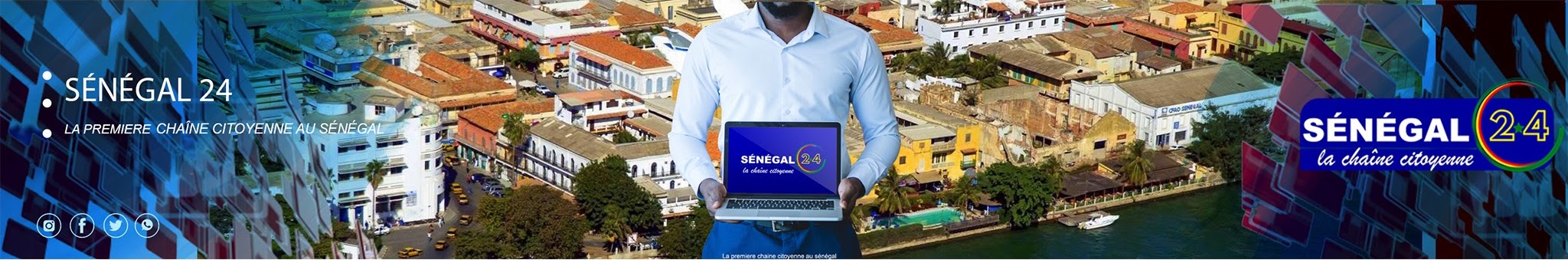International
Gabon : le Président de la Transition général Oligui Nguema reçoit le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra

Le président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce 5 septembre 2023 le président de la République centrafricaine (RCA), Faustin Archange Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) «facilitateur du processus politique» après le coup d’État contre Ali Bongo Ondimba, selon la télévision d’État. La CEEAC a chargé le président de la RCA «d’engager des pourparlers» avec «tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays» pour «un retour rapide à l’ordre constitutionnel».